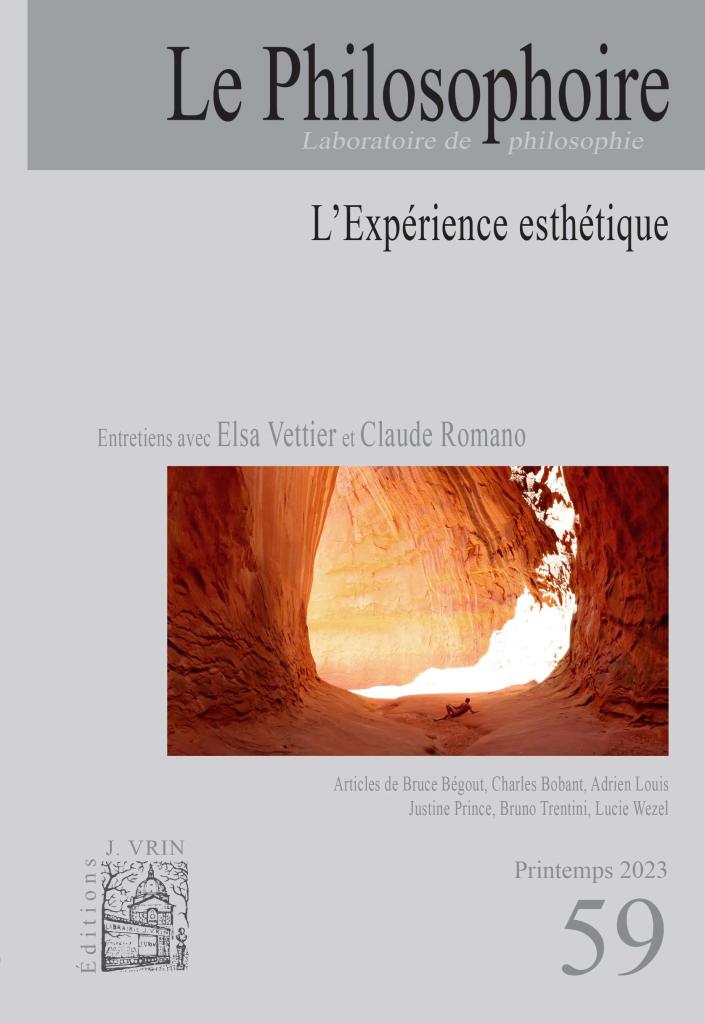Appels à contributions
13/02/2024
Appel à contributions pour le n°62 – « Le Bien commun »
La date limite de remise des contributions (articles, recensions, entretiens, traductions) est fixée au 15 sept. 2024, à l’adresse vincentcitot@hotmail.fr
Appel à contributions pour le n°63 – « Enseigner »
La date limite de remise des contributions (articles, recensions, entretiens, traductions) est fixée au 15 janvier 2025, à l’adresse vincentcitot@hotmail.fr
Humain / Transhumain n°60
14/12/2023
Acheter le pdf n°60 sur scopalto / Acheter des contributions au détail sur Cairn
Humain / Transhumain
– Editorial. Les philosophes et le transhumanisme, par Vincent Citot
– Entretien avec Jean-Michel Besnier, par Agnès Louis
– Entretien avec Luc Ferry, par Mathias Goy
– Deux manières d’en finir avec l’homme : transhumanisme et écologie, par Alexis Piat
– La révolution transhumaniste ou le suicide de l’humain. Une morale du renoncement, par Guillaume Fauvel
– Faut-il en finir avec la nature humaine ?, par Adrien Louis
– Éthique de l’intelligence artificielle et transhumanisme : l’immortalité fait-elle la vie ?, par Christine Leroy
– La guerre de demain sera-t-elle juste ? Soldat augmenté et éthique de la guerre, par Pierre Bourgois
Les Livres Passent en Revue
– Peut-on réfléchir à l’islam sans considérer nos problèmes politiques ? À propos de Sur l’islam, de Rémi Brague, par Adrien Louis
– Une autre éducation libérale (à propos de L’égoïsme vertueux de Thierry Gontier), par Baptiste Jacomino
– Notices sur quelques publications récentes et ouvrages envoyés à la rédaction : Judith Coffin, Antonio Damasio, Philippe Danino, Jean-Michel Geneste, Philippe Grosos et Boris Valentin, Thibaut Gress, Patrick Juignet, Yann Le Cun, Claude Obadia, Sylvie Paillat, Lluis Quintana-Murci, Daniel Susskind, Frédérique de Vignemont
Hors Thème
– Entretien avec Philippe Grosos. La philosophie au risque de la préhistoire, par Vincent Citot
– Universalisme ou différentialisme : analyses et arguments pour aborder des questions contemporaines, par Laurent Fedi
– Casuistique du « principe responsabilité » : l’éthique jonassienne et la fin de vie, par Lyvann Vaté
Editorial du n°60
06/05/2023
Editorial
Les philosophes et le transhumanisme
Vincent Citot
Comme il n’est pas contre-indiqué d’appuyer sa réflexion sur des faits, commençons par l’un d’entre eux : à deux exceptions près, les articles reçus pour le dossier « Humain / Transhumain » de ce numéro sont tous hostiles au transhumanisme[1]. Pour des raisons diverses, certes. Mais tout de même, cela interpelle : pourquoi les philosophes, qui ne sont habituellement d’accord sur rien, se retrouvent ici ligués contre le projet transhumaniste ? Le Philosophoire n’est peut-être pas le meilleur laboratoire pour juger des rapports de force, mais la consultation des rayons concernés dans les librairies produit le même résultat : critiquer le transhumanisme est une sorte de sport intellectuel auquel on s’adonne volontiers dans le milieu philosophique.
Alors que j’évoquais la question devant des étudiants (en philosophie), l’un d’eux me fit la remarque suivante : « C’est peut-être tout simplement qu’on a de bonnes raisons d’être méfiants vis-à-vis de ces technologies ». C’est bien possible. Si l’on sonde les philosophes pour savoir s’ils sont favorables aux épidémies et aux violences conjugales, ils feront montre du même unanimisme « anti- » ; on n’en attend pas moins d’eux. Mais l’explication est un peu courte, car les arguments transhumanistes ne sont pas sans force. Ils ne sont pas invincibles, mais enfin ils donnent du fil à retordre. Pour le plaisir de la pensée et la nécessité d’équilibrer ce numéro, en voici quelques-uns.
Tout d’abord, améliorer l’espèce humaine (par des moyens techniques) est un projet éminemment sympathique. Sauf à croire que l’homme est issu d’une Création et n’a pas lieu d’être retouché, étant parfait. Ou bien que, toutes les valeurs étant relatives, aucune direction ne saurait être privilégiée parmi les divers axes – tous arbitraires – « d’amélioration ». Mais l’on vient de voir que si l’on faisait un numéro sur les épidémies et les violences conjugales, 100% des contributions afficheraient une franche hostilité à l’une et à l’autre. Dans ces conditions, manipuler génétiquement l’être humain pour le rendre moins malade ou moins violent ne peut être déclaré mauvais sans examen. Nous pratiquons d’ores et déjà l’eugénisme par repérage de maladies génétiques et malformations pendant la grossesse, et interruption de celle-ci, le cas échéant ; alors pourquoi ne pas étendre cette pratique grâce à de meilleurs diagnostics prénataux et une manipulation génétique ciblée ? J’entends bien l’avertissement de prudence : « Si l’on s’engage dans cette voie, jusqu’où ira-t-on ? Jusqu’à choisir la couleur des yeux de son enfant ? ». A quoi l’on peut répondre que nous y sommes déjà engagés (dans la voie eugéniste), et que fixer des limites éthiques et juridiques aux manipulations génétiques ne sera pas plus difficile dans le futur qu’aujourd’hui. Autrement dit, les décisions peuvent se prendre au fur et à mesure et il n’y a pas lieu de rejeter en bloc le transhumanisme.
Inutile de discuter ici l’argument naturaliste (le « respect de la nature humaine »), car il est utilisé dans tous les camps et de toutes les façons. On s’oppose au transhumanisme au nom de la nature humaine, mais d’autres montrent astucieusement qu’il est typiquement humain de chercher à s’améliorer, se dépasser et techniciser son existence. En outre, l’organisme humain (cerveau compris) est lui-même un produit culturel, au moins depuis la maîtrise du feu par Erectus et le perfectionnement de son outillage. C’est ce que l’on appelle la coévolution bioculturelle : la culture permet d’améliorer l’adaptation à l’environnement, de mieux se nourrir, donc de disposer d’un surcroît de calories qui peuvent être investies dans l’entretien d’un cortex de plus en plus gros (et énergivore) ; lequel permet en retour d’améliorer l’adaptation à l’environnement en inventant de nouveaux outils, etc. Ce que l’on appelle « la nature humaine » est le résultat multimillénaire de cette coévolution et de la sélection naturelle. Quant à la sélection sexuelle (choix du/des partenaires et comportement reproducteur), elle a tout autant façonné « la nature humaine ». Nous sommes tous les produits macrohistoriques de manipulations génétiques indirectes (rétroactions nature-culture) et de sélections génétiques (reproduction discriminatoire). On ne trouvera ici ni argument pro (car ce qui a été la règle depuis des millions d’années peut cesser de l’être si nous le décidons), ni argument contra (car le passé n’est pas nécessairement un anti-modèle).
Les anti-transhumanistes craignent, à juste titre, que ces techniques ne tombent entre de mauvaises mains, qu’elles donnent lieu à une sorte de biopouvoir totalitaire, ou au contraire qu’elles servent un capitalisme débridé avec extension exponentielle du domaine marchant et accroissement consécutif des inégalités. On peut toutefois remarquer que ces dangers sont le propre de toute innovation technique. L’invention de l’écriture pourrait être tenue responsable des mauvais livres qui ont été écrits par la suite, coupable de l’abattage de millions d’arbres et à l’origine d’une formidable inégalité entre les lettrés et les illettrés. Toute technique nouvelle ouvre des possibilités novatrices de nuisances. Les techniques transhumanistes ne sont, de ce point de vue, pas nouvelles.
Le transhumanisme promet d’accroître notre intelligence (par manipulations génétiques ou implants de puces électroniques). Qui est contre ? Cela risque d’augmenter les inégalités, dit-on, entre ceux qui pourront se faire « augmenter » et les autres. Dans ce cas, le problème n’est pas le transhumanisme en tant que tel, mais le fait que tout le monde ne puisse s’offrir un produit de luxe. Pourquoi ne pas simplement réclamer « le transhumanisme pour tous ! »… Les recettes politiques classiques trouveraient-elle soudain leur borne ? Les socialistes et les communistes peuvent parfaitement appliquer leurs idées et ajuster leurs programmes en régime transhumaniste (accessibilité universelle, régulation, taxation, redistribution, éducation, contrôle, etc.) ; de même les libéraux, qui ne manquent pas de remarquer que tous les individus souhaitent pour leur propre compte être augmentés, améliorés, soignés et prolongés. Le camp conservateur quant à lui ne sera pas muselé par une ingénierie génétique ou électronique, mais pourra toujours avancer ses arguments. Le transhumanisme n’empêchera personne d’être anarchiste, républicain, démocrate, révolutionnaire ou réactionnaire. Bref, les diverses solutions politiques aux problèmes nouveaux ne seront pas nécessairement nouvelles, de sorte qu’il ne paraît pas utile de dramatiser la question transhumaniste.
Arrêtons-là le jeu des objections aux objections. Il s’agissait, non de montrer quoi que ce soit, mais d’emprunter, par petites touches, un point de vue qu’on ne trouvera guère dans la suite de ce numéro. A la question initiale (« pourquoi une majorité de philosophes est hostile au transhumanisme ? »), la réponse ne me semble pas pouvoir être simplement : « parce que c’est évidemment nuisible ». Derrière les arguments, je crois discerner quelque chose d’autre. Je soupçonne que le positionnement des philosophes vis-à-vis du transhumanisme n’est pas sans rapport avec leur méfiance séculaire vis-à-vis de la « technoscience », voire de la science en tant que telle. A l’âge classique (XVIIe-XVIIIe siècles), les philosophes sont majoritairement des philosophes-savants ; au postclassique (depuis la fin du XVIIIe siècle), qui voit s’accélérer la spécialisation disciplinaire et l’autonomisation des diverses sciences, en même temps que l’économie s’industrialise, nombre de philosophes adoptent une posture critique vis-à-vis de la science et de la technique.[2] Il s’agit d’une tendance massive, d’un Esprit-du-temps, et non d’une simple convergence d’arguments. Le transhumanisme n’est peut-être qu’une occasion nouvelle d’alerter contre les dangers du monde moderne – tâche à laquelle la philosophie « postclassique » consacre une attention particulière, par pente historique, en quelque sorte, plutôt que par rationalité pure.
Mais au-delà des raisons et du contexte, l’hostilité au transhumanisme s’enracine dans la sensibilité commune. N’importe quel individu à qui l’on présente le projet de changer l’espèce humaine a des frissons et se demande à quel hurluberlu il a affaire. On sait ce que l’on va perdre sans avoir de garantie sur ce que l’on pourrait gagner. Or on ne joue pas sa vie, ni celle de sa descendance, ni celle de ces congénères sur ce qui ressemble à un pari aventureux. La réticence est, pour ainsi dire, instinctive – pas de puces dans mon cerveau ni de robots dans mes veines ! Les philosophes, dotés comme tout le monde d’une prudence spontanée, cultivent en outre, par profession, une répulsion envers les montreurs de marionnettes. Or les transhumanistes de la Silicon Valley, prophétisant une humanité meilleure moyennant quelques investissements lucratifs, rappellent les illusionnistes conspués par Platon. L’esprit critique est donc sollicité.
Mais par ailleurs, confrontée à une maladie grave et incurable, l’immense majorité d’entre nous accueillerait favorablement n’importe quelle expérimentation technique, « pourvu que ça marche ». De même, on a beau dire que philosopher, c’est apprendre à mourir, quand la mort sonne à la porte, la plupart d’entre nous ne serait pas contre une petite dizaine d’années de vie supplémentaire, au prix d’un pacte avec la technoscience. Enfin, qui refuserait – pour réussir un examen, obtenir un emploi mieux rémunéré ou simplement épater son beau-frère – de décupler sa mémoire et d’avoir accès à Wikipédia, moyennant un petit dispositif aussi peu contraignant qu’un sonotone derrière l’oreille ?
Le transhumanisme suscite ainsi réticence et adhésion, selon les circonstances. Mais dans le premier cas, la réaction sensible se prolonge aisément en arguments ; tandis que dans le second, la volonté de vivre plus longtemps, en bonne santé et sans contraintes se passe de raisonnements – et même ringardise les raisonnements. Tout le monde veut vivre plus et mieux. C’est pourquoi la bio-ingénierie ressemble à une marée montante, et les philosophes à des sémaphores qui, au milieu du tumulte, indiquent aux bateaux la direction du port.
[1] Il s’agit essentiellement d’envois spontanés. On peut définir le transhumanisme comme le projet intellectuello-politique d’améliorer les performances et les conditions de vie de l’espèce humaine, par des moyens techniques tels que la manipulation génétique et l’implant électronique.
[2] Voir V. Citot, Histoire mondiale de la philosophie, Paris, PUF, 2022.
Editorial du n°59
03/12/2022
Editorial
Quelques hypothèses sur expérience l’esthétique et sur l’art
Vincent Citot
Au sens courant, avoir une expérience esthétique c’est faire l’épreuve du beau. Autant qu’on puisse savoir – grâces aux données des diverses sciences humaines et de l’archéologie –, aucun peuple ni aucune culture au monde n’est tout à fait étranger à ce sentiment. Quand on n’est pas sensible à la beauté des choses, on ne dépense pas inutilement son énergie à ornementer des cavernes, des outils, armes, pots, habitats, vêtements et coiffes. Or aucune société au monde n’ignore l’ornementation, quel qu’en soit le support – pierre, bois, peau, os, tissu, métal ou digital. Les plus vieilles parures connues à ce jour remontent à 142 000 ans[1]. Quand on n’est pas sensible à la beauté des choses, on ne dépense pas non plus son temps et son argent, on n’use pas ses semelles et ses jambes, à randonner. Qu’est-ce que randonner, sinon disperser de la chaleur et produire du CO2, sans autre objectif que le plaisir de la marche dans un cadre esthétique ? Or les promeneurs-randonneurs affluent du monde entier pour contempler les merveilles de la nature – Grand Canyon du Colorado, Mont Fuji, Chutes du Niagara ou encore sommets alpins. Bref, il semble que l’expérience esthétique soit une expérience universelle et intemporelle (ou presque), en ce sens qu’aucun groupe de Sapiens connu, dans l’espace et dans le temps, ne semble y échapper.
Bien entendu, on peut dire que devant le même paysage, les individus et les groupes ne ressentent pas exactement la même chose, car la psychologie de chacun, l’âge, le sexe, la classe sociale, la culture et l’époque importent. Et la langue peut exprimer de multiples façons les sentiments esthétiques, ce qui indique leur complexité et leur diversité. Le joli n’est pas exactement le beau, qui n’est pas exactement le sublime, le grandiose, le merveilleux, le mignon, etc. Mais toutes ces tonalités affectives se répartissent sur une même palette, qui est l’expérience esthétique, c’est-à-dire l’expérience de la beauté en un sens large et non technique. On peut faire autant de distinctions que l’on veut, entre beauté d’un visage, d’un corps, d’un dessin, d’un paysage, d’un chant, d’un geste (technique, sportif, moral), d’une ville, d’un poème, d’un vase, d’un ciel… in fine, tout cela peut être dit beau.
Qu’un sentiment ait une telle universalité et extensivité est l’indice qu’il remplit une fonction essentielle pour l’homme. Un peu comme la peur, le désir sexuel, le dégoût, la fatigue, la soif et la faim. Si ces sentiments sont universels, c’est parce que ceux qui ne les ressentaient pas n’ont pas eu de descendance – car ils ont été dévorés par un prédateur faute d’avoir peur, sans partenaire sexuel faute d’avoir du désir, empoisonnés faute d’avoir du dégoût, etc. On pourrait donc faire l’hypothèse que le sentiment esthétique remplit une fonction évolutionnaire. Il nous rend désirables les personnes fertiles et en bonne santé, les lieux propices à l’installation d’un campement et les objets travaillés manifestant des aptitudes rares chez un partenaire social – savoir-faire, maîtrise, intelligence, patience, accès à des matériaux précieux. En somme, la beauté fonctionnerait comme un système de fléchage : elle indiquerait ce qui est bon pour notre vie et notre reproduction.
Les objections affluent : en quoi la contemplation d’un canyon ou d’un désert, c’est-à-dire de lieux dangereux, serait-elle propice à la vie et à la reproduction ? Ne peut-on pas trouver beaux des visages ridés et usés par le temps ? Des ruines, des terrains vagues, des prédateurs, la nuit étoilée et autres choses qui n’ont apparemment rien à voir avec la théorie de la sélection naturelle ? Il est vrai qu’un réductionnisme étroit n’apporte aucune lumière ici. Mais il faut aussi considérer qu’une des propriétés essentielles de l’humanité est de détourner des programmes psychologiques issus de l’Evolution. Par exemple, le désir sexuel a une fonction évolutionnaire, mais l’on peut désirer hors du cadre reproductif. Le plaisir gustatif nous incite originairement à manger ce qui est bon pour notre organisme, mais on peut aimer partager un repas sans avoir faim et sans nécessité de survie. Les exemples de « détournement de sélection naturelle » abondent. Le sentiment de beauté en fait partie. Son universalité pourrait s’expliquer par l’histoire évolutionnaire, mais sa relativité dépend d’autres facteurs.
Parmi ces facteurs explicatifs complémentaires figurent en bonne place les conditions socio-économico-culturelles. Le programme réductionniste est, à ce niveau également, à la fois éclairant et limité. Une société et une culture données trouvent « beau » ce qui manifeste leurs idéaux et donne chair aux valeurs qu’elles promeuvent. Or ces idéaux et valeurs doivent correspondre de près ou de loin à des besoins sociaux, et faciliter la perpétuation et la prospérité des sociétés en question. Car, selon un raisonnement déjà appliqué à l’espèce humaine, les sociétés dont les valeurs mettaient en danger leur propre existence n’ont pas persévéré dans leur être, ont périclité, ont disparu[2]. Ainsi, chaque époque et chaque culture donnerait à voir une architecture, un art et éventuellement une littérature qui traduiraient, sous certains aspects et indirectement, leurs besoins sociaux. Indirectement, parce qu’aucune société ne projette des valeurs esthétiques par effets mécaniques de conditions socio-économiques. De même que notre espèce pratique le « détournement de sélection naturelle », les agents sociaux font du « détournement de mécanismes infrastructurels ». On ne peut pas déduire du besoin sociopolitique d’orthodoxie la beauté figée des icônes orthodoxes, pas plus que les œuvres romantiques du XIXe siècle d’une société basculant dans la révolution industrielle et l’individualisme. La sensibilité esthétique correspond aux idéaux d’une société donnée à une époque donnée, mais la formulation de ces idéaux et leur traduction esthétique ne s’explique pas par des lois sociologiques simples.
En effet, ce ne sont pas des « sociétés » abstraites qui créent des œuvres et ressentent leur beauté, mais des personnes singulières, avec leurs goûts, préférences et créativité propre. Après être passé du niveau de l’espèce à celui de la société, il faut descendre à l’échelle individuelle. A nouveau, le réductionnisme est partiellement explicatif. N’est-il pas vrai que chacun trouve beau ce qui va dans le sens de ses dispositions psychologiques (aspirations, désirs, tempérament) ? Nous apprécions esthétiquement ce qui nous conforte dans notre être, nos schémas mentaux et nos valeurs. Il est rare de faire aimer ceci ou cela à quelqu’un qui s’y est d’abord montré hostile, et inversement. Et pourtant, il n’est pas moins vrai que les goûts s’éduquent et que la complexité des sentiments esthétiques n’est pas explicable d’une façon linéaire par le génome ou la chimie cérébrale. Chacun est capable de faire quelque chose de ce que ses gènes font de lui, de sorte que nos expériences esthétiques et nos jugements de goût ne se font pas sans nous, dans l’irresponsabilité génético-neurologique. Pas de « détournement de cerveau » à proprement parler, certes, mais néanmoins, ce n’est pas « mon cerveau » qui juge et ressent, c’est moi.
Au total, que l’on se place au niveau de l’espèce humaine (Homo estheticus), de la société ou de l’individu, et que l’on cherche à expliquer l’expérience esthétique par des causes sous-jacentes ou des actions émergentes, une thèse résiste et subsiste : nous trouvons beau ce qui a de la valeur pour nous – en tant que spécimen, agent social ou personne singulière. La beauté, c’est la valeur incarnée dans la perception sensible, la valeur rendue perceptible, la valeur perçue. Tout ce qui a de la valeur est susceptible d’être esthétisé, et réciproquement – un cours d’eau qui descend de la colline, un idéal (une cathédrale et sa symbolique), un artefact (un propulseur magdalénien sculpté), une action morale (un acte héroïque), une réalisation technique (la prouesse d’un acrobate) et finalement l’intelligence elle-même (un théorème mathématique). Tant que nous serons capables de valoriser et de percevoir, d’une part, et de rendre perceptibles des valeurs, d’autre part, il y aura pour nous de la beauté.
On appelle couramment art (vs artisanat) la capacité de produire artificiellement (vs naturellement) du beau, c’est-à-dire de susciter l’admiration via la perception (vs l’intellection pure) d’un artefact ou d’une performance (sonore, gestuelle, etc.). Des bifaces acheuléens[3] aux œuvres les plus contemporaines, l’art répond à ce critère d’admiration-valorisation par la perception. Le plus souvent, l’art associe beauté et fonctionnalité : esthétisation de quelque chose qui a une finalité quelconque – religieuse, politique, morale, cathartique ou autre. On ne peint pas au fond des grottes paléolithiques de l’Ardèche pour donner un musée des beaux-arts aux membres du clan ; on ne construit pas les pyramides de l’Ancien empire pour embellir la « sky line » de Memphis ; ni les temples d’Ellora en Inde pour le plaisir désintéressé des yeux. En général, esthétiser, c’est rendre attrayant ce que l’on veut promouvoir. L’esthétisation et le maquillage répondraient ainsi au même objectif : rendre désirable, séduire, donner du plaisir (à l’œil, à l’oreille) pour accélérer l’accomplissement d’une fin (amoureuse, religieuse, politique ou autre). L’esthétisation est une incitation, un facilitateur, un accélérateur – ce qui n’ôte rien à l’intensité ni à l’authenticité du sentiment correspondant.
L’histoire enregistre deux exceptions à cette règle : l’art qui voudrait n’être que beau, sans lien avec une fonction quelconque, donc parfaitement autonome ; l’art qui voudrait se passer du beau, au nom d’une autonomie supérieure encore. C’est le cas d’une partie de[4] ce qu’il est convenu d’appeler « l’art contemporain »[5]. Mais en rompant avec la beauté, celui-ci semble retrouver, paradoxalement, la fonctionnalité anthropologique de l’art que les « beaux-arts » et « l’art moderne » avaient mise à distance. En effet, la beauté a toujours été – pour les outils, habitats, corps, chants religieux, gratte-ciel… – une sorte de supplément d’âme ; si l’on ôte la dimension esthétique, il reste, à l’état brut, l’usage originaire : poterie pour manger, poignard pour chasser, maison pour s’abriter et objet de prestige pour briller en société. En prenant congé du beau, « l’art contemporain » ne fait que rendre manifestes ses fonctions – stratégies sociales de distinction et prestige de la muséalité, provocation politique, dénonciation morale, amusement ironique ou encore réflexion conceptuello-philosophique. Dans la mesure où tout cela a de la valeur et demeure candidat à l’admiration, c’est de l’art au sens habituel, aussi douloureuse l’amputation du plaisir esthétique soit-elle.
[1] Sehasseh El M., Fernandez P., Kuhn S. et al. (2021), « Early Middle Stone Age personal ornaments from Bizmoune Cave, Essaouira, Morocco », Science Advances, 7.
[2] Ce qui donne à méditer sur les valeurs morales, politiques et esthétiques dominantes aujourd’hui – mais ne nous éloignons pas de notre sujet.
[3] Certains sont trop symétriques, trop nombreux et trop peu usés pour avoir été de simples outils ; ceux-là seraient donc des objets de prestige et des signaux d’aptitudes (indicateurs de la valeur sociale et cognitive de l’artisan).
[4] Une autre partie déplace et complexifie (plutôt qu’elle n’annule) le sentiment esthétique.
[5] Qui est, selon Nathalie Heinich, un paradigme plus qu’un repère temporel (Le paradigme de l’art contemporain, Paris, Gallimard, 2014).